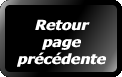Eléments de réflexion pour un bilan d'étape.
Le festival est né doucement avec l'idée de proposer une réflexion sur les ruralités d'aujourd'hui.
Comme on le dira encore plus loin, le documentaire constituait de ce point de vue un vecteur dynamique, puisque chacun y entre avec ses idées et ses émotions, son appréhension de la vie, ses jugements construits sur des héritages mentaux et sur un environnement conceptuel porté par les média…
En ce sens le documentaire offrait un potentiel, à plusieurs niveaux; comme élément déclencheur de l'expression et comme élément d'élargissement des horizons, des connaissances et donc une remise en question des a priori contenus dans les discours dominants. Le documentaire avait ce pouvoir de passeur, qui combine, par le contenu et la forme, une dimension charmeuse, émotionnelle et une dimension réflexive, intellectuelle.
A - Rapide esquisse d'une typologie des films visionnés :
En gros nous pouvons les classer en quelques rubriques… un classement qui ne saurait privilégier aucune forme, mais qui souhaite mettre le doigt sur des réactions personnelles à certains types de films et ainsi lancer un débat…
- - ici et ailleurs, le monde rural comme il va
Une première rubrique, disons géographique et qui par un côté encore trop limité au regard de cinéastes francophones, justifie le caractère international du festival. Les débats, les angles de vues ne seront pas enfermés dans un domaine franco-français, voire régional.
Cette variété permet d'élargir les horizons et par la confrontation des situations, permet d'établir des échelles dans la gravité des situations tout en aiguisant la réflexion sur la convergence des récits de vie. La mondialisation des destins, plus que par un long discours théorique, entre par petites touches dans les consciences, grâce à la multiplication des analogies dans les parcours de vie. Là les films auxquels on pense seraient nombreux, "Khol sa steng la rentrée des classes", de Victoire SURIO et Yann LARDEAU avecles enfants des montagnes du Tibet, confrontés à leur avenir scolaire et aux questions de l'eau…film qu'on rapprocherait du film sur la survie d'un lycée du Kazakhstan…"The principal" de Lavrenty Son
- - les peurs et la vigilance, danger !
Nous avons vu aussi bon nombre de films de mise en alerte. Comme si la fonction du documentaire, nous y reviendrons devait servir à la prise de conscience directe des dangers que courent et la planète et ceux qui la peuplent difficilement. On pense entre autres, à "Gens de Yanoun" de C.Shammas & J.C. Perron sur l'avenir incertain d'un village palestinien.
Ce sont les films au constat souvent lucide mais amer, qui mettant le doigt sur les inégalités et les souffrances engendrées par les absurdités d'un monde gagné par la cupidité, ne cessent d'être un cri de dénonciation. Je pense ici à tous les films qui montrent les difficultés de la vie des ruraux d'Amérique comme "Paysan sans terre" de Julien Farrugia" ou d'Afrique "36 choses à faire avant l'An 200" de J.F.Hasque…La liste est longue et rappelle que près de nous aussi la vie des ruraux change, se complique… au Portugal, en Italie et à la périphérie de nos villes comme dans les zones reculées de la moyenne montagne française.
- - l'engagement collectif et individuel
Plusieurs films dépassent alors cette dénonciation et proposent , souvent comme modèle, des expériences limitées mais qui se veulent symboliques du refus: on dit non, on tente d'inverser des tendances et soit seul, soit en groupe, on essaie de changer la donne. Je pense à "Campagne perdue" de Stéphane Goel, montrant la résistance d'éleveurs suisses regroupés dans une étable communautaire. On se souvient du film de Manuel Poutte "En vie", montrant la résistance aux diktats des logiques commerciales et du film "Ce qu'on fait à Florennes" montrant une résistance collective contre les OGM, et bien sûr, on a en tête aux films de Christina Tran. Dans le même registre, "La campagne du médecin" de Christian Gaudare…
Mais parfois la générosité et le volontarisme ne suffisent pas et plusieurs films ont montré les limites ou les échecs d'entreprises initiées avec la meilleure volonté du monde. On songe à "Classe Burkina" de G.Renaud, ou à "Du jus dans les cailloux" de Philippe Lafitte.
- - le dépaysement et le rêve
Enfin d'autres documentaires n'ont d'autres propos que de tendre des miroirs à nos êtres, de nous renvoyer à l'intimité de nos vies et de nos pensées. Ils savent, avec lenteur, souvent sans paroles et sans effets sonores, installer comme un vide en nous. Ils nous dépouillent en quelque sorte, et offrent dans le déroulement des séances une respiration, un temps mort dans l'agitation du débat. Loin de s'écarter de la ruralité, ils en appellent à la réflexion nécessaire sur ce besoin bien humain d'élargissement du champ de vision, d'un dépaysement qui ne repose pas sur l'exotisme, mais sur l'abandon momentané de soi pour mieux se retrouver peut-être. On pense à "De Profundis" d'Olivier Ciechelski, méditation sur la solitude à l'évocation de la Chartreuse engloutie dans un lac du Jura et dans une moindre mesure à "Magui ou le génie du Lac" de Pierre Amiand et même à " Roulotte perdue" de J.Y Varin, qui nous transporte au rythme des chevaux des manouches…
- - Classement par le ton, le formatage
Il serait un peu vain de dire que le documentaire subit la loi du genre par un arbitrage impitoyable et hégémonique, la diffusion télévisée.
Mais c'est un sujet qu'il conviendrait de développer … je pense que l'on pourrait par exemple, comme nous l'avons voulu dans la programmation 2007, comparer sur ce plan , les documentaires sur la médecine dans le monde rural… il aurait fallu pousser le débat sur la forme, mais le fond était déjà très polémique et le temps a manqué pour comparer le traitement d'un même sujet, par deux cinéastes qui n'avaient pas la même manière de filmer, de construire leur propos…
Situation totalement inverse la veille, où le débat sur la forme des films a relégué le débat sur la transmission de la terre, sur la place des femmes à la campagne… curieux !
La seule garantie que le festival devrait pouvoir offrir, c'est que le débat se mène et sur le fond et sur la forme. ……
B- Les documentaires comme passeurs d'émotions et d'idées.
Si l'image a un pouvoir, il est toujours un peu court de l'évoquer sans préciser la nature de ce pouvoir. Si le documentaire et les débats vont vers une rupture de conscience, il est délicat de préciser comment naît cette prise de conscience. D'ailleurs, en quoi le documentaire, l'image d'une manière plus large, participent-ils de ce processus de manière spécifique ? C'est rapidement ce que nous allons essayer de comprendre à l'expérience des centaines de films sur le monde rural visionnés depuis une dizaine d'années.
- - D'abord rêver ? …
Plus que par leur fond démonstratif et argumenté sur l'avenir du monde rural, le public, je crois est d'abord pris (au sens captif du terme) par l'ambiance d'un lieu, et les personnages qui l'habitent. On entre dans le sujet par la porte inconsciente du climat d'arrière plan !
Sans revenir sur l'éternel débat entre réel et fiction, personne ne contestera que dans le documentaire, on touche d'abord à cette fibre qui n'est pas directement le sujet du film, du moins le propos didactique du sujet. On le voit bien dans le film centré sur un végétal, «L'arganier» d'El Houssine BAKHOURY, dont l'objectif rejoint grosso modo les documentaires à valeur d'alerte que nous évoquerons plus loin et qui constitue la trame du film. Mais qui a remarqué les autres végétaux qui composent ce paysage marocain ? Directement peut-être le spécialiste de la flore régionale des latitudes basses sous influence océane ! Donc peu parmi nous ! Et pourtant notre inconscient a enregistré comme un élément du tout cette diversité paysagère. Un peu à la manière d'une peinture, elle se fond dans un ensemble, et sans s'en distinguer particulièrement elle ne peut en être soustraite.
On perçoit dans l'image, dans l'arrière plan, l'harmonie d'un équilibre - disons naturel - ou du moins façonné par des générations d'occupants et déjà, même si ce n'est pas ce que nous mettrions en avant de premier abord en voyant un tel documentaire, il n'empêche, la force de l'image sur le discours, c'est cette inscription équilibrée de l'ensemble de la matière vivante, de l'écosystème au sens premier du terme qui reste en tête et construit implicitement la prise de conscience évoquée plus haut.
On songe ici à «Chronique de la forêt des Vosges» un film de François Chilowicz, ou à «Tameksaout- la bergère» d'Yvan BOCCARA. Deux films qui prennent le temps de nous installer dans la lenteur des lieux et nous captivent insensiblement. Nous sommes ici dans le registre émotif inconscient, certes fortement préconstruit par l'esprit du temps qui nous dit le beau, le naturel, et qui nous charme par réflexe empathique! Trois classes de 5ème l'an passé sont restées attentives et charmées par le film d'Yvan BOCCARA un documentaire où en apparence il ne se passe rien; 80 minutes où la vie se déroule dans une lenteur infinie, sous le soleil, un ciel bleu éclatant sur des rocailles ocres, des petits gestes à cent lieues de la frénésie des séries habituelles ! Seule la magie des lieux emporte les adolescents dans une respiration lente du temps, comme en apnée d'une époque qui déroule le film de nos vies en accéléré!
Je sais ce n'est pas très scientifique, et même tout à fait subjectif, d'autant que le vivant dans sa diversité ne se voit pas toujours, et que la mort des variétés animales ou végétales n'est pas toujours spectaculaire! On y reviendra plus loin. Seule dans ce "tissu vivant qui couvre notre planète du plus petit au plus grand", la mise en scène de la mort des espèces familières sensibilise. Et la sauvegarde d'espèces menacées pose parfois problème comme le montrait le film «Un loup pour l'homme» de Pierre BRESSIANT , sujet sensible de la réintoduction d'une espèce qui disparaît, comme les ours des Pyrénées.
Pour le moment, retenons que la puissance d'un documentaire, quelle que soit son intention pédagogique ou "militante", c'est d'emblée de nous faire partager un lieu, de l'accueillir. Je ne peux m'empêcher de penser que c'est le premier pas vers la mobilisation mentale nécessaire à la réaction. Je songe à cette immense taïga du film d'Ivan GOLOVNEV « Tiny Katerina » au programme cette année; avant la dernière image, personne ne sait qu'elle est menacée et avec elle ceux qui y vivent, ceux qui en vivent, et la révolte qui nous prend à la fin, sans discours explicite, est d'autant plus forte que ces lieux nous ont été offerts avant, que nous les avons habités !
C'est sur ce mode sensible que fonctionnent (pas bête, la télé), en l'exploitant à fond les reportages sur l'exotisme de paysages donnés comme immuables référents à la rêverie dépaysante, avec parfois une touche larmoyante sur leur fragilité. Mais en omettant de donner une réponse aux questions qu'ils suscitent - la faute à qui si c'est en danger?- ils saturent les esprits d'insolite (le bien connu contraste qui attire, l'esprit touriste, qu'on retrouvait en partie dans «Le chemin de senteurs» le film de Bernard IBOUTH qui nous transportait sur les hauteurs de l'île de la Réunion au milieu des géraniums dont on extrayait l'essence.
Par la force de l'accoutumance émotive, ils banalisent les enjeux et désamorcent bien souvent les réactions citoyennes. Abusant de cette émotivité immédiate, la télévision n'attend que des sujets formatés contre le zapping, ceux qui vont scotcher l'auditoire par la sensiblerie mêlée de dramatisation outrée!
- …ou informer ?
A l'inverse de cette imprégnation plus ou moins consciente, la présentation filmée d'une démarche résolue de sauvegarder une espèce, un lieu, un paysage, un mode de vie, (on pense ici à «Gardiens du paysage» film de Robin HUNZIGER…où un agriculteur s'est fixé l'objectif de maintenir sa vallée dans l'état de carte postale de son enfance) s'inscrit, elle, de manière totalement volontariste; les changements sont perçus sur le mode nostalgique et dénonciateur !
Là on exigera du documentariste de dire de manière explicite les raisons de la colère.
On demandera à l'image de donner toute la puissance de l'argumentation spécifique, de fournir la preuve de l'existence des espèces vivantes et de la mise en danger d'une société rurale. N'est-ce pas la fonction du documentaire scientifique et pédagogique, mettant en scène le propos botaniste qui décortique la mécanique de la plante et peut par des allers-retours spatiaux ou dans le temps, apporter par l'image la preuve de la disparition progressive d'espèces, d'essences ou au contraire la prolifération de plantes invasives…On retrouve par moments ce discours dans «l'arganier» ! Ajouté au comptage mathématique, un peu à la manière d'un zoologiste ou d'un démographe, le scientifique dans un tel documentaire rejoint alors le terrain précédent, celui de l'émotion; mais d'une émotion d'une autre nature, plus intellectuelle, qui ne s'inscrit plus dans l'ordre de la contemplation mais dans l'ordre de la réaction. Que cette dernière relève ensuite de l'indignation ou de l'indifférence face à l'illustration des constats.
Ici s'inscriraient les films à vertu pédagogique comme les chaînes du savoir en diffusent, sur les écrans de télévision . Ils rejoignent le vieux souci de vulgariser la connaissance hors de l'école et doivent naviguer entre la leçon dite ennuyeuse et la fiction onirique pour éduquer. ( Jules Verne le faisait déjà en vulgarisateur de la science sur un mode fictionnel) On y reviendra un peu plus loin.
Mais décrire suffit-il ?
… alors crier ?
Dans le festival nous recevons aussi des films dont le propos est plus direct et qui sonnent comme un cri.
Si alerte il faut donner, c'est le rôle des documentaires sur l'irresponsabilité des pratiques agricoles intensives, les OGM, les pesticides, nitrates, vaches folles, béton, feu, barrages, etc…On pense à «Le tracteur d'orgueil» , film de Patrice GOASDUFF qui montre les excès d'un productivisme mécanisé et encouragé plus ou moins directement par la PAC et qui piège l'agriculteur dans un mode de culture difficile à inverser. On songe au film «Ce qu'on fait à Florette» ou à «Un autre monde», documentaire de Stacis STOUPIS , qui dénoncent la course en avant des bricolages génétiques. On pense enfin au film «Le secret des dieux» d'Olivier MAGIS qui montrait les ravages de la vache folle…
De manière moins visible, encore que les jours d'incendies les médias en parlent sur le ton de la fatalité, «Ca sent le roussi», le film d'Arnaud BRUGIER stigmatise la fuite en avant des habitats résidentiels dans l'arrière pays méditerranéen en Roussillon, mettant en danger un mileu de garrigue et de maquis, fragiles formations de substitution, d'une forêt dégradée depuis des siècles! La mise en danger d'étendues forestières déjà plus ou moins épargnées, c'est aussi ce que « Le maïs et la cendre» , film de Chantal Blanc-PAMARD, soulignait déjà en montrant le recul de la forêt par extension de la culture du maïs à Madagascar, Et sur un autre ton , pointant vers d'autres responsabilités, celles de la nouvelle donne dans les pays ouverts récemment à la libéralisation du marché, «Lopukhovo» documentaire de Jara MALEVEZ l'an passé , décrivait la surxeploitation de la forêt en Ukraine.…Certes on ne mettra pas sur le même plan le recul de la forêt pour étendre le profit et pour se nourrir. C'est ce que disent après en avoir fait un sommaire inventaire, tous les documentaires sur l'avancée des déserts…et la fragilisation des zones sahéliennes, qui sans aborder toujours le sujet directement, posent la question de l'eau, des plantes et surtout remettent en cause le bien fondé de méthodes importées et souvent inefficaces pour les hommes (tous pointent la responsabilité de l'échange inégal, plus que la remise en cause des savoir-faire ) et surtout destructrices pour les terroirs. On songe alors à tous les films sur la coopération africaine
De ce point de vue, le film d'Al Gore «Une vérité qui dérange» peut constituer l'archétype. Un film qui se veut témoignage explicite et plaide pour un engagement citoyen. Il dépasse le discours de la déploration émotive cher aux télévisions, le constat désenchanté d'un monde qui ne respecte guère la planète, assombrit le futur et insiste sur l'urgence de la prise de conscience pour agir.
Là le regard est impliqué et le point de vue documenté cherche à mettre les points sur les i…Il s'agit non seulement de décrire, mais aussi de dénoncer une situation devenue intolérable, comme le montrait "Vies nouvelles» le documentaire de Liping WENG et Olivier MEYS sur les conséquences humaines et écologiques du barrage des Trois gorges en Chine que "Still life", œuvre fictionnelle vient de mettre à son tour en question !
Le documentaire serait un manifeste, un appel à l'action.
Nous sommes ici sur le registre de la vigilance et de la mobilisation, pas toujours sur celui du changement collectif ou individuel d'attitude, mais cela vient !
On pense pour cette année 2007 au film d'Alain RIES « Tous n’ont pas dit oui » qui suit les mobilisations à Bure, contre l'enfouissement des déchets nucléaires et la vision un peu méprisante de la campagne comme poubelle potentielle ! On songe aussi au documentaire « Le Mbissa » d'Alexis FIFIS et Cécile WALTER, qui montre les conséquences désastreuses de la modifaction d'un cordon littoral au Sénégal, pour les hommes et pour l'écosystème côtier.
- Rêver ou informer…les deux mon documentariste !
En fait nous recevons beaucoup de documentaires mettant en scène l'harmonie d'un lieu, d'un paysage avec ses hommes et ses femmes…Pourquoi ? Dans le film sur l'Arganier, comme précédemment dans «Parfum de roses, paroles de femmes» d'Emanuelle SCHIES, et pour faire court, la puissance de l'image, outre l'émotion et la démonstration, réside aussi dans la découverte pleine d'empathie, de civilisations vivant avec une nature menacée.
Le spectateur n'a pas besoin qu'on lui rappelle sans cesse à chaque plan la difficulté du monde. C'est avec cette sensibilité informée là, en éveil, qu'il sent que ce monde qu'on lui donne à voir est fragile. Il sait que ces pratiques et ces lieux auront du mal à garder leur originalité dans un monde qui s'accélère et risque de tout emporter avec lui dans son tourbillon frénétique.
En effet, et plus certainement, c'est l'association des deux registres d'émotion, celui du rêve et celui de la connaissance, qui nous font réagir devant les images de cultures différentes; par l'artifice ethnographique en fait, c'est-à-dire en replaçant l'homme dans ces "milieux", l'homme coupable, l'homme victime, l'homme responsable, trois figures en fait que les documentaristes donnent le plus souvent à voir, notamment dans les milieux à forte pression humaine ou au contraire dans les milieux "vides" et fragiles.
Mais, un peu comme les récits de vie réussis, il ne s'agit pas d'alterner à la manière du mille feuilles, une tranche de rêve, une tranche de vécu, une tranche de sensible, une tranche d'explications et ainsi de suite…Tout l'art, car le documentaire est œuvre de création, n'en déplaise aux censeurs qui le tiennent pour mineur, est justement dans ce mariage subtil des deux émotions… Ensemble elles se nourrissent et en se nourrissant elle nous transportent un peu plus loin, elles nous grandisssent un peu plus.
Dans ces documentaires, entrent en scène des hommes déboussolés, scandalisés, qui voient partir sans raison des pans de paysages familiers et se rompre des équilibres anciens, …impuissance , souffrance. On se rappelle «Murmures de ruisseau», documentaire d'Abdelkrim Khiari qui dénonçait dans un Parc National d'Algérie, l'inconséquence d'une planification d'Etat et surtout l'impossibilité de s'opposer aux tracés routiers programmés. Un film à l'image de beaucoup de ceux que nous avons cités ici, pour n'évoquer que ceux qui, plus ou moins directement, touchent du regard la remise en cause visible de l'espace naturel.
Enfin l'homme responsable, un peu à la manière de ce que nous tentons de faire dans ce festival.
Certains films donnent désormais à voir que loin de l'impuissance et de la résignation face à la mise en danger de la nature certains disent non et non seulement dénoncent, manifestent, témoignent mais changent aussi leurs comportements. Par un engagement collectif comme dans le film «En vie» de Manuel POUTTE, mettant en scène de nouvelles attitudes, de nouvelles pratiques respectueuses de l'environnement ou par des façons de vie plus individuelles, forcemment plus limitées, comme dans le film "Vivre en ce jardin" de Serge STEYER , expérience singulière de glaneurs à la Varda qui vivent désomais dans un jardin d'Eden retrouvé !
Cette année, plus que la force du film scientifique et didactique, un film comme «L’eau, la terre et le paysan» de Christian ROUAUD, nous donne à réfléchir à la fois sur la nature menacée, ici les algues proliférantes dans une baie de et sur le bouleversement personnel qu'un changement de pratiques culturales entraîne pour un individu, une famille. La force, encore une fois du propos réside dans ce balancement entre la réalité dénoncée, la réaction immédiate de chacun devant le désastre visible, et la réponse sensible à la question de chacun: « Que faire ? »
Que faire en attendant les solutions globales que préconise un Al Gore par exemple. Que faire chacun dans son coin, dans sa pratique avec sa part de responsabilité? Faire de sa vie un discours à valeur pédagogique comme ses anciens ouvriers de la région nantaise évoqués plus haut dans le film de Serge STEYER . Se retirer et à la manière des ermites indiens de Louis Malle, vivre hors du temps, dans une moyenne montagne à flanc des Pyrénées, comme dans «Derrière les arbres» le documentaire de Bénédicte Pagnot.
Que faire avec ses angoisses, ses peurs ses rêves ses doutes… un film comme celui de Christian ROUAUD, qui mêle tout cela, à mon avis , sans renier la puissance de la dénonciation, qui donne la mesure du chemin qui est devant chacun avec humilité mais résolution, porte davantage, puisque là, notre imaginaire en se nourrissant de réel raffermit nos convictions ! Car on n'attire pas les consciences seulement avec la réalité, même quand elle est dramatique ! Le risque de la mise en scène récurrente de la tragédie écologique, nous l'avons efleuré plus haut, c'est l'accoutumance au jeu avec le mal et au bout du compte, l'inefficience d'un discours pourtant si nécéssaire!
Bref il faut les deux! Le rêve et la réalité mêlés pour nous faire grandir et agir……le documentaire idéal finalement, non ?




CAMERAS DES CHAMPS